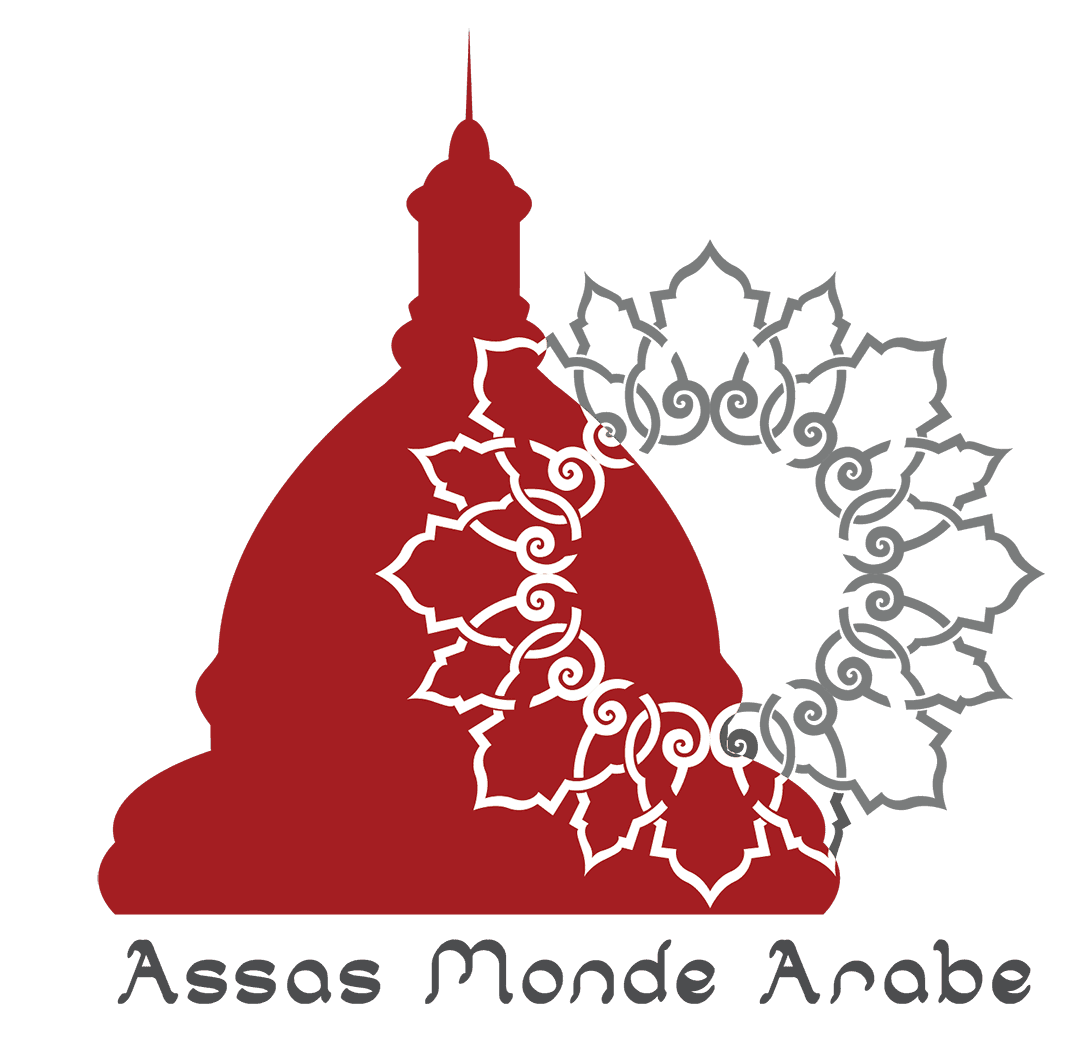L’Organisation Sioniste Mondiale de 1897 à 1948 : Le gisement institutionnel de l’Etat d’Israël
- par Seki Courcoux
- •
- 06 avr., 2021
- •
« A Bâle j’ai fondé l’Etat juif », écrit Theodor Herzl écrit dans son journal, en septembre 1897. Ces mots sont ceux du journaliste juif autrichien qui a fondé l’Organisation Sioniste Mondiale (O.S.M.). Cette organisation à but non-lucratif, dont le siège social se trouve aujourd’hui à Jérusalem, en Israël, a été pendant un demi-siècle le fer de lance du mouvement sioniste.
Au sens moderne du terme, le sionisme renvoie à l’idée d’un retour du peuple juif vers la Terre Promise, et son établissement au-travers d’un Etat souverain. La ‘aliyah, la montée vers la terre biblique d’Israël, est un objectif qui a toujours existé, mais qui est longtemps resté propre à des franges restreintes : rabbins, universitaires, intellectuels religieux… Le mouvement sioniste, lui, s’est propagé au sein de populations très majoritairement européennes à partir du XIXe siècle, notamment parmi les élites intellectuelles et laïques de la communauté juive d’Europe centrale et de l’Est. Les pogroms, expulsions, pamphlets et autres exactions anti-Juifs - encore légion dans certaines régions alors que l’Europe était supposée avoir embrassé les Lumières et la modernité - ont motivé de nombreux Juifs européens à revendiquer leur droit de résidence, voire de souveraineté sur une terre sur laquelle ils ne seraient jamais l’Autre, l’Etranger : celle que Dieu leur a promise, correspondant à la région historique de la Palestine, alors sous domination ottomane.

Ces différentes structures, jouissant d’une légitimité croissante, tant en diaspora qu’au sein du yishouv (le foyer juif en Terre Promise), parviendront à avoir un ancrage, des moyens, et surtout des pouvoirs assimilables à ceux d’un véritable Etat. Partant de ce constat, la déclaration d’indépendance d’Israël de 1948 apparaît davantage comme une reconnaissance, une consécration, plutôt qu’une création ex-nihilo. En bref, une continuité certaine peut s’observer entre l’appareil institutionnel israélien et l’Organisation Sioniste Mondiale et ses ramifications. Trois pôles conventionnellement reconnus comme l’apanage d’un État seront ici étudiés pour illustrer cette idée, de manière non-exhaustive, mais représentative : la notion de pouvoirs centraux et de déconcentration ; le domaine de la banque et de la finance ; les milices et le monopole de la violence légitime.

L’approche qui en sera faite n’est pas une analyse de constitutionnaliste proprement dite mais relève davantage d’histoire et de science politique comparées, entre les systèmes antérieurs et postérieurs à 1948. Ce regard critique sur les institutions relèvera de la chose politique, en tant qu’il tiendra également compte des acteurs individuels de l’Organisation Sioniste et de ses émanations. En effet, l’intégration des institutions de l’OSM à l’infrastructure étatique israélienne s’est parallèlement accompagnée de l’intégration de tout un personnel, accroissant l’effet de continuité entre l’appareil de l’Organisation et Israël. L’establishment des premières décennies de l’histoire d’Israël est issu d’un sérail relativement homogène, issu des rangs de l’Organisation Sioniste et ses satellites. Jusque dans les années 1970, la quasi-totalité des dignitaires et responsables politiques israéliens sortait, soit des rangs de la nébuleuse de l’OSM, soit des puissants conglomérats européens de gauche tels que la Histadrout, le Mapaï, ou Po’alei Tzion – Golda Meir est par exemple une des chefs d’Etat à être davantage issus de cette « caste socialiste ».
Rappelons également que l’OSM, qui existe encore aujourd’hui, ne sera ici considérée que dans le premier demi-siècle suivant sa création, autrement dit, jusqu’à la proclamation d’indépendance de l’Etat hébreu.
Du Premier Congrès vers un proto-Etat
Pendant les vingt premières années de son existence, l’Organisation Sioniste Mondiale a su tisser un vaste réseau d’influence, en ralliant à elle la grande majorité des congrégations revendiquant les idéaux sionistes, y compris celles qui lui étaient antérieures, à l’instar du mouvement russe ‘Hibbat Zion, fondé en 1881. Le Mandat britannique sur la Palestine, instauré en 1920 suite au conflit mondial, accéléra conséquemment le développement de l’OSM. Son implication dans l’organisation de la ‘aliyah, l’accroissement de son nombre d’adhérents, et la légitimité conférée par le soutien politique britannique, l’ont érigé en un vaste complexe organisationnel. Tant et si bien que le Congrès Sioniste Mondial, consortium de l’OSM réuni tous les un, deux ou trois ans, vota en 1920 la création d’une branche exécutive qui serait implantée en Palestine : l’Agence Juive. Cette séparation traduit alors la conscience qu’avait l’Organisation de l’envergure qu’elle avait atteinte et des moyens qu’elle avait acquis. Dans les trois pouvoirs traditionnellement distincts par la doctrine constitutionnaliste, la première étape d’une séparation entre eux s’est ici opérée : le pouvoir législatif de l’OSM d’un côté, et le pouvoir exécutif de l’Agence Juive de l’autre …avec une prédominance de la première.

L’OSM, par la création de l’Agence Juive, a ainsi vu ses ambitions et la réalisation de son programme se concrétiser significativement par la création d’une représentation directe et officielle, présente auprès des communautés juives de Palestine. Alors que bon nombre des associations et congrégations sans étiquette religieuse étaient essentiellement des partis et des syndicats de travailleurs, l’Agence Juive s’est imposée comme une véritable autorité auprès du yishouv. Ses moyens humains et financiers, lui ont progressivement conféré de facto des pouvoirs d’ordre administratif, puis reconnus de droit par l’autorité britannique mandataire, qui a fini par désigner l’Agence Juive comme organe représentant tout le yishouv palestinien devant la Couronne.
Pendant toutes les années 1920, l’Agence Juive, dont la politique était définie lors des Congrès Sionistes tenus en Europe, s’impliqua dans tous les domaines relevant des affaires publiques et locales des Juifs de Palestine : enseignement, développement des kibboutzim (fermes agricoles), mais aussi et surtout la gestion de l’immigration. Les prérogatives croissantes de l’Agence, sa responsabilité devant les Britanniques, et la distance géographique vis-à-vis des instances décisionnaires européennes de l’Organisation Sioniste, ont finalement abouti à une séparation entre l’Agence et l’OSM, en 1929, pour faciliter le travail des deux entités. Bien entendu, le personnel et la ligne politique de l’Agence Juive restèrent dans la continuité des idéaux de l’Organisation, et la relation d’influence maintenue entre les deux organismes resta étroite …et l’est toujours aujourd’hui.
Au moment de la déclaration de David Ben Gourion proclamant l’indépendance d’Israël, l’Agence était devenue l’organisme administratif de référence pour tous les Juifs nouvellement installés, traitant continuellement des milliers de dossiers d’immigration. Immédiatement après la création de l’Etat, le conseil d’administration de l’Agence Juive renonça à l’écrasante majorité de ses prérogatives pour les mettre au profit direct du nouvel état. Même si l’Agence dispose d’un régime juridique particulier, elle est considérée comme un organisme d’Etat, en grande partie soumis à l’agenda politique du gouvernement et de la chambre législative. Depuis 1948, elle a signé de multiples accords avec le gouvernement, et des mesures votées par l’assemblée législative la concernant sont régulièrement ratifiées. Un « transfert » de personnel de l’Organisation Sioniste et de l’Agence a été opéré immédiatement après l’indépendance. Leur compétence et leur implication dans la vie du yishouv les ont naturellement propulsés vers les instances décisionnaires et de pouvoir de l’Etat.
L’exemple le plus évident et représentatif est celui de Haïm Weizmann, premier Président d’Israël. Sa victoire est d’une symbolique forte puisque pendant une vingtaine d’années, ce dernier a présidé l’Organisation Sioniste Mondiale. Considéré comme l’héritier de Theodor Herzl, il a durablement marqué l’Organisation, en cherchant à s’attirer le soutien et les fonds d’une communauté toujours plus vaste, et pas seulement restreinte à une élite bourgeoise aux tendances socialistes. Au-delà du seul cadre de l’OSM, il est considéré comme un des pères fondateurs du sionisme moderne. Au regard de l’unanimité de sa popularité, tout particulièrement au lendemain de la Guerre, son élection ne surprit pas.
Levi Eshkol, lui, a été nommé troisième Premier Ministre d’Israël, avec un mandat marqué par la victoire de 1967 de la Guerre des Six-Jours. Rapidement élu comme délégué de l’Organisation, il a été particulièrement impliqué au sein de l’OSM, en qualité de représentant à Berlin, notamment dans les premières heures du IIIe Reich. Il a pu engager les premières négociations avec les Nazis pour faire émigrer les populations juives vers la Palestine. Outre son portefeuille ministériel, la création de la compagnie nationale de distribution d’eau, Mekrorot, est de son fait. Existant déjà sous le Mandat Britannique, elle a été nationalisée rapidement après la déclaration d’Indépendance et assure même la distribution d’eau dans les Territoires Palestiniens de nos jours.
Si, de son côté, l’Agence Juive ne jouit pas d’un portefeuille ministériel, le rôle qu’elle occupe dans la gestion de la ‘aliyah et l’installation des nouveaux immigrés la rend indispensable dans le dispositif administratif israélien, en témoignent les trois millions de dossiers qu’elle a pris en charge depuis sa création. Par ailleurs, un sixième de son financement provient de nos jours de l’Etat lui-même, le reste venant très majoritairement de dons et du fonds de réparation de l’Allemagne. Les différentes personnes ayant assumé sa présidence ont également constitué un large contingent de hauts cadres de l’administration israélienne, dès la constitution du premier gouvernement. L’Agence Juive a donné à l’Etat hébreu son Premier Ministre le plus emblématique, David Ben Gourion, avec douze ans de service en tant que chef du gouvernement. Plus grand contributeur à l’architecture du nouvel État, toute la décennie des années 1950 est marquée par son mandat. Sa pérennité se doit en très grande partie à la popularité incontestée dont il a joui, après plus de dix ans de direction de l’Agence Juive. La gestion presque gouvernementale des affaires liées au yishouv opérée par l’Agence sous ses directives, a fait de lui un chef attendu par la population juive au moment de la création d’Israël. En première ligne face aux Britanniques pour discuter des modalités de l’Indépendance, c’est lui qui proclama la création de l’Etat, et qui devint chef de l’Etat à titre provisoire en 1948.

L’effet de gravitation du mouvement sioniste autour de l’Organisation Sioniste Mondiale s’illustre également dans l’intérim qu’a assuré Golda Meir, première femme à la tête de l’Etat hébreu, à la tête de l’Agence Juive, en 1946. Davantage impliquée dans les organisations politiques de gauche, ces dernières ont toujours gardé un lien étroit avec l’OSM et ses filiales. Il n’a pas été rare que des membres haut-placés de ces conglomérats occupent parallèlement des postes dans un bureau relevant de l’Organisation Sioniste, le meilleur exemple étant David Ben Gourion, investi tant dans l’Agence Juive que dans le Mapai, le parti des travailleurs. C’est notamment cette porosité qui expliqua l’intérim assuré par Golda Meir au sein de l’Agence Juive. Ce sont ces représentants de l’OSM versés dans le militantisme socialiste qui donneront le ton de la tendance politique israélienne jusqu’à la fin des années 1970.
Outre la direction de l’Agence Juive, ses divers départements ont également été un vivier de futurs dirigeants au sein de l’Etat. Moshé Sharrett, premier Ministre des Affaires Etrangères et successeur de David Ben Gourion en tant que Premier Ministre, était un membre actif au sein de l’Agence Juive. A la tête du département politique de l’Agence à partir de 1933, son expérience dans la représentation politique du futur Israël et dans les relations étrangères, était déjà celle d’un « diplomate officieux » chevronné au sein de l’Agence. Dans une attribution similaire, Eliezer Kaplan, nommé Ministre des Finances dès 1948, a été trésorier de l’Agence Juive pendant quinze ans.
Un système bancaire transméditerranéen et des devises
L’Organisation Sioniste Mondiale a également su être précurseur dans les questions banco-financières. Dans une dynamique comparable à celle de la création de l’Agence Juive, les initiatives et les décisions prises à dessein logistique dans ces affaires, ont su muter en outils suffisamment fiables pour être intégrés à la nébuleuse institutionnelle israélienne après 1948.
La structure la plus représentative du pragmatisme herzlien en la matière, est le Jewish Colonial Trust, créé dès le deuxième Congrès Sioniste, en 1899, en tant que premier organe de financement de l’Organisation Sioniste Mondiale. De ce Jewish Colonial Trust émane une filiale, en 1902, destinée à s’implanter directement en Palestine : il s’agit de l’Anglo-Palestine Bank. L’utilité première de cette banque était d’assurer les importations et les transactions, tout particulièrement les achats de terres. A l’époque, la Palestine encore sous domination ottomane voyait certaines de ses parcelles de terres arables rachetées par les fonds du mouvement sioniste. C’est dans ce type d’activité que la prospérité de l’Anglo-Palestine Bank se développe, dopée par l’ouverture de succursales sur tout le territoire.

Le quasi-monopole de la filiale au moment de l’indépendance d’Israël a, sans surprise, suscité l’intérêt de l’Etat nouvellement créé. Le gouvernement fraîchement formé a désigné l’Anglo-Palestine pour imprimer les premiers billets des nouvelles devises, la livre israélienne, consacrant la légitimité et la reconnaissance du statut de la banque. Dans la même dynamique que l’Agence Juive, l’Anglo-Palestine Bank a abandonné une partie de ses prérogatives, comme l’achat de terres, pour se consacrer à des activités commerciales classiques et à soutenir la construction du nouveau pays. Le nom qu’elle a adopté en 1950, traduit lui aussi cet esprit : la banque Anglo-Palestine devient officiellement la Bank Leumi, littéralement « la Banque Nationale ». Aujourd’hui, elle est la banque la plus importante d’Israël, avec l’Etat comme actionnaire majoritaire, à près de 15% des parts, et est considérée comme la « fille aînée » de la Bank of Israel, du fait de son ancienneté, de sa prééminence et de l’effort fourni lors de la crise des actions de 1983, au cours de laquelle elle a été momentanément nationalisée.

Un autre aspect du pragmatisme organisationnel de Herzl est la création du sheqel sioniste. La mission confiée à la Banque Anglo-Palestine d’émettre les premiers billets israéliens n’est pas la première victoire dont l’Organisation Sioniste Mondiale puisse se vanter. En effet, antérieurement à cela, l’ébauche d’un système monétaire a été pensée dès les premiers Congrès Sionistes. Le sheqel a été défini comme une unité de valeur, à la manière d’une devise évaluée en bourse, permettant la participation à l’achat de terres, mais aussi le droit de vote et d’éligibilité au cours des Congrès. Pour une somme définie par les délégués de l’Organisation Sioniste, les adhérents potentiels devaient acheter un sheqel pour voter ou se présenter comme délégué potentiel. Outre l’accès aux suffrages, le sheqel était le moteur de « l’effort de guerre » du mouvement sioniste. La puissante symbolique liée à cette monnaie dont le nom renvoie aux pièces versées aux prêtres du Temple de Salomon, d’après la Bible hébraïque, a été employée dans d’importantes campagnes de sensibilisation (parfois qualifiée de propagande au regard de l’objectif politique poursuivi). Pendant cinquante ans, le sheqel, à mi-chemin entre la devise et l’action bancaire, a été un pilier de l’Organisation Sioniste et de ses organismes satellites, constituant sa première source de revenus. Il n’a pas été émis en liquidités, ne pouvant être échangé ni en Europe, ni en Palestine, mais son rôle d’unité de valeur au même titre que le lingot d’or ou le baril, relève d’un tour de force pour une congrégation comme l’OMS, qui ne comptait que quelques milliers d’adhérents lors de sa création. David Ben Gourion, premier Président d’Israël, dira de ce sheqel qu’il fut un «gage de citoyenneté» pour les Juifs de diaspora et du yishouv.
La continuité n’est ici que formelle, mais il est intéressant de noter que la monnaie ayant succédé à la livre israélienne en 1980 a été baptisée sheqel, un nom qui se veut porter en lui l’esprit pionnier et démocratique du sheqel herzlien des Congrès Sionistes.
Les carcans d’une armée régulière
Parmi les Juifs issus des Premières ‘Aliyah, à partir de la fin du XIXe siècle, nombreux sont ceux qui ont été mus par un sentiment conquérant, les poussant à s’armer et à se fédérer en milices. Les différentes révoltes, récurrentes sous le Mandat britannique, ont nourri une animosité de ces milices vis-à-vis des Arabes, perçus comme une menace, et vis-à-vis des Britanniques, considérés comme hostiles au développement du foyer juif. Le Lé’hi, l’Irgoun, la Haganah, sont les principaux groupes armés de pionniers juifs connus pendant la première moitié du XXe siècle. Du fait de leurs actions clandestines, de leur nature irrégulière, et de leur dotation illégale d’armes, les autorités britanniques n’ont pas tardé à les identifier comme des organisations terroristes et à les traquer …sauf une.
En effet, la Haganah est la seule à avoir bénéficié de la grâce des Britanniques, malgré son statut non-officiel paramilitaire. La principale raison derrière cette exemption fut l’allégeance un premier temps officieuse de la Haganah envers l’Agence Juive. Contrairement aux autres groupes armés, celle-ci a accepté de se soumettre à la hiérarchie d’une autorité juive, en l’occurrence la branche exécutive de l’Organisation Sioniste Mondiale. En toute logique, l’éthique régnant dans les rangs de la Haganah, insufflée par l’Agence, était fidèle aux idéaux revendiqués par l’OSM : mixité, modèle égalitaire et démocratique, religiosité très modérée, socialisme, etc étaient des valeurs très tôt enseignées au sein de la milice. L’accroissement des pouvoirs publics et administratifs de l’Agence Juive dans les années 1930 s’est donc étoffé d’une prérogative normalement étatique, celle de la violence légitime.

La Haganah, jouissant alors de la bienveillance des Britanniques, a ainsi été sollicitée par l’autorité mandataire pour tenter de démanteler les autres milices, et même équipée pour se préparer à affronter les troupes allemandes de l’Afrikakorps, très tôt présentes dans l’Egypte voisine, au cours de la Seconde Guerre Mondiale. L’organisation militaire supervisée par l’Agence Juive, la reconnaissance britannique la consacrant presque en armée régulière, ont fait de la Haganah un corps armé homogène, fidèle, structuré et éprouvé au baptême du feu.
Sa participation victorieuse à la Guerre Civile (ou Guerre d’Indépendance) en 1947-1948 face aux troupes arabes palestiniennes, lui a inévitablement conféré un statut officiel lors de l’Indépendance. La Haganah est ainsi devenue l’Armée de Défense d’Israël (en hébreu : Tséva ha-Haganah lé-Yisra’èl), nom qui n’est pas sans rendre hommage aux origines de la structure armée.
Le basculement vers l’Indépendance a donc vu l’allégeance de la Haganah se reporter sur le gouvernement et l’Etat, et non plus vers l’Agence Juive et l’Organisation Sioniste. Toutefois, cette allégeance de jure n’est pas un un revirement idéologique, puisque l’armée a elle aussi été encadrée pendant les premières décennies d’Israël par un corps d’officiers largement issus de la Haganah, alors imprégnée des idéaux des pionniers de l’OMS et de l’Agence Juive. Le caractère universel, social, et la mixité promue par ces entités se sont tous retrouvés dans les valeurs revendiquées par l’Armée de Défense d’Israël.

Le secteur militaire israélien, institution aujourd’hui controversée par une partie de la population mais longtemps restée respectée de façon unanime, a connu une caste à part entière de chefs d’état-major issus de la Haganah. La régularisation de l’entité paramilitaire s’est suivie d’un transfert presque intégral de ses têtes pensantes. Leur valeur avait été éprouvée lors de la guerre de 1947-1948 et de la protection de populations qu’elle a impliquée. Considérés comme des héros de la Nation, ces chefs sont inscrits au panthéon de l’histoire nationale et culturelle, les faits d’armes étant la charpente du sentiment patriotique dans l’imaginaire israélien. Par exemple, Yaakov Dori, puis Moshe Dayan, chefs d'État-Major, étaient de ces gradés de la Haganah rompus aux combats de la première guerre israélo-arabe, sans oublier de mentionner Yitzhaq Rabin, considéré comme le Premier Ministre (1992-1995) le plus engagé dans le processus de paix entre Israël et Palestine, qui s’est lui aussi engagé dans la Haganah dès l’adolescence, et devenu chef d’Etat-Major en 1964. Au-delà des seules fonctions militaires auprès du gouvernement, les anciens de la Haganah ont également rejoint des fonctions politiques classiques, l’exemple le plus parlant étant Yitzhaq Navon, cinquième Président d’Israël, après une longue carrière dans les rangs de la Haganah.
« A Bâle, j’ai fondé l’Etat juif » ?
Au regard du transfert de hauts responsables de l’Organisation Sioniste Mondial vers l’administration de l’Etat israélien, ainsi que du mimétisme de l’agrégat institutionnel de ces deux structures, les paroles de Theodor Herzl ne semblent pas exagérées. Considérant le long développement d’organisations aux responsabilités délimitées par l’OSM sur toute la première moitié du XXe siècle, la Déclaration d’Indépendance de 1948 s’apparente davantage à un palier franchi ou une reconnaissance, qu’à un véritable commencement. La création de l’Etat hébreu a ainsi eu pendant une vingtaine d’années les traits d’une véritable extension de l’Organisation Sioniste. Dans sa capacité à négocier avec différentes autorités étatiques (le Royaume-Uni et l’Empire ottoman, en particulier), à se doter de prérogatives de puissance publique et à jouir de pouvoirs habituellement propres à un Etat, l’OSM a réussi à repousser les limites des compétences d’une organisation non-gouvernementale. La facilité avec laquelle l’Organisation et ses dirigeants ont réussi à investir les fonctions de direction de l’Etat témoigne du statut de proto-Etat que l’OSM avait atteint, d’autant plus que cette transition politique s’inscrivait dans un contexte peu commun. Le départ des Britanniques, les bouleversements démographiques (citons l’exode des Arabes palestiniens ainsi que l’afflux toujours croissant d’immigrés juifs au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale), les dégâts du conflit, et la création du régime, sont autant de facteurs qui auraient pu entraver la stabilité et la continuité d’un nouvel Etat.
Sans le travail de l’Organisation Sioniste Mondiale, la création de l’Etat hébreu n'aurait été inenvisageable en si peu de temps. Des acteurs externes à l’essaim de l’OSM ont certes contribué à l’établissement et à la création de l’Etat, mais l’installation et la sécurité des populations, la base de nombreux services publics, et le développement d’une élite technocratique israélienne, relèvent du fait de l’Organisation. Comme l’affirme Theodor Herzl, l’ampleur du chantier institutionnel débuté dès la création de l’Organisation Sioniste Mondiale amène à faire remonter la véritable genèse de l’Etat hébreu à 1897, plutôt qu’à 1948.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
Georges Ayache Les Douze piliers d’Israël (2019)
Ilan Greilsammer Le Sionisme (2005)
Henri Bentégeat Chefs d’Etat en guerre (2019)
David Ben Gourion Les Israéliens et les autres Juifs (1959)
United Shekel Committee and Central Election Board of Great Britain and Ireland History of the Shekel (1956)
Michel Abitbol Histoire d’Israël (2018)
Ressources numériques
Les Clés du Moyen-Orient Sionisme et création de l’Etat d’Israël (2018)
Site de l’OSM : www.wzo.org.il
Jewish Virtual Library Zionism: World Zionist Organization (WZO)
The Central Zionist Archives The Zionist Shekel (2017)
Autres
Discours de Theodor Herzl au Premier Congrès Sioniste (1897)


Considérées individuellement, les économies nationales ne semblent pas avoir été affectées de la même manière par la récession économique liée à la crise sanitaire. Celle-ci a montré les forces et les faiblesses, les capacités d’adaptation et de résilience, révélé les particularités de chaque économie. La crise est un moment où tout bascule, où apparaît un dysfonctionnement majeur. Si elle peut être une période de troubles, la crise peut aussi être un kaïros, un moment à saisir pour savoir et comprendre. Parce qu’elle révèle le réel , elle est une occasion formidable de s’interroger sur le fonctionnement d’une société. Pour dire simplement comme le fait le philosophe Charles Pépin, « c’est quand cela ne marche pas que nous nous demandons comment cela marche ». Ainsi, la crise sanitaire en ce qu’elle expose les singularités propres à chaque système économique conduit ici à s’intéresser, à travers la finance islamique, à la relation qu’il existe entre religion, notamment l’Islam, le droit et l’économie.
Alors que l’Islam était pour Max Weber un obstacle au développement économique, la finance islamique est aujourd’hui en plein essor. Relativement récente, elle a pour point de départ la création de la Banque islamique du développement en 1974 qui fait la promotion du développement économique dans les pays musulmans. Les banques occidentales s’intéressent à la finance islamique qui, bien que s’adressant en priorité aux musulmans reste ouverte sur le monde. La finance islamique passionne par son appartenance à une industrie financière éthique remise en lumière par la crise des subprimes de 2008. Les principes religieux s’inscrivent dans le droit qui régule l’activité bancaire islamique.

La culture marocaine s’exporte de plus en plus grâce à la mondialisation et ses relais, tels qu’internet et les médias. Le roi Mohammed VI a par ailleurs proposé depuis le début de son règne une politique étrangère fondée sur le libre-échange des biens, services et arts ainsi que sur le dialogue avec nombre de pays européens. Cette ouverture progressive tend à favoriser toutes les couches de la société marocaine ainsi que ses manifestations artistiques, comme celle qu’est le rap.
Cette évolution du rap marocain profite à l’entièreté du monde arabophone et à son économie. Elle se justifie par la véritable ascension d’une unité artistique puissance. Néanmoins, les premiers acteurs de cette puissance, les artistes, font face à certains obstacles politiques et institutionnels censurant leur art ou leur empêchant de gagner décemment leur vie. Fort heureusement, les supports médiatiques et leur source inépuisable de créativité permettent aux artistes marocains de faire porter leur art le plus loin possible et aux oreilles des plus chanceux. L’objectif de cet article est de témoigner de l’élévation de la culture rap marocaine sur une grande scène, celle du Maroc et potentiellement celle de l’Europe ainsi que de la volonté sans faille des artistes marocains.

Ce récent évènement montre l’ambition de l’Arabie Saoudite, mais plus généralement des pays arabes, dans la course mondiale à l’innovation technologique et plus particulièrement dans le secteur de l’intelligence artificielle. Machine learning, deep learning, voitures autonomes, reconnaissance faciale, villes intelligentes et même robots pour certains ; les grandes puissances de ce monde sont entrées dans une course à l’innovation dans l’intelligence artificielle, considérée comme la quatrième grande industrialisation. Bien que selon Neil Sauvage, du Nature 2020 Index Artificial Intelligence, la Chine, les Etats-Unis et l’Europe se partagent le podium des leaders mondiaux du domaine, les pays arabes ne veulent également pas non plus rater cette opportunité estimée selon la société d’audit PricewaterhouseCoopers, à 15 700 milliards de dollars de contribution à l’économie mondiale d’ici 2030 dont 320 milliards pour la région Middle East North Africa.
Dans cette folle course à la nouvelle industrialisation, trois pays se distinguent dans le monde arabe par leur potentiel à s’imposer comme de futurs hubs de l’intelligence artificielle dans la région. Ce sont les Emirats arabes Unis, l’Arabie Saoudite ainsi que l’Egypte. En effet, selon les recherches du PwC, la part estimée de l’IA d’ici 2030 dans le PIB des Emirats Arabes Unis est estimée à 13,6%, presque autant que les économies d’Amérique du Nord dont la part d’ici 2030 est estimée à 14,5%, à 12,5% pour l’Arabie Saoudite et enfin à 7,7% pour l’Egypte. Toutefois, ces prévisions réjouissantes ne sont que des prévisions et il s’agit maintenant aux concernés de mettre en place tout ce qu’il y a en leur pouvoir pour les réaliser. Signe révélateur que le message a été reçu : les gouvernements saoudiens et émiratis ont placé l’IA au centre de leurs stratégies économiques avec, respectivement, le programme Vision 2030 pour l’un, et le programme Artificial Intelligence Strategy 2031 pour l’autre. Le gouvernement égyptien a également donné une priorité à l’IA dans sa stratégie économique en voulant la développer au maximum.
Mais quelles sont réellement les raisons qui poussent ces gouvernements à donner autant d’importance au développement de l’IA ? Quels sont les moyens mis en place ? Y a -t-il déjà des résultats ? Ont-ils vraiment les moyens de leurs ambitions ? Quels sont les obstacles ?
Il s’agira de montrer dans cet article comment l’IA placée par ces gouvernements ambitieux en tant que priorité nationale entraîne la mise en place de projets pharamineux, devant toutefois faire face à des obstacles politiques et technologiques.
L’ intelligence artificielle : une priorité de gouvernements ambitieux
Quelles sont les raisons poussant les gouvernements arabes à investir dans l’intelligence artificielle ?
Un « cadeau empoisonné » . Voilà comment maintes économistes décrivent la rente pétrolière et gazière sur lesquelles reposent les économies du Golfe et ce en raison de la volatilité des prix de ces énergies mais également en réponse au développement constant d’énergies alternatives prêtes à supplanter les gaz et le pétrole. Il est urgent pour l’Arabie saoudite ainsi que pour les EAU de préparer la diversification de leurs économies afin de préparer leur économie à une nouvelle ère. L’investissement dans la technologie de l’IA représente donc une voie logique à suivre en ce qu’elle représente une opportunité de plus de 320 milliards de dollars pour les 10 ans à venir. De l’autre côté, l’ Egypte possède une économie certes diversifiée, mais qui se doit de redécoller après les nombreuses crises politiques de cette dernière décennie ayant paralysées le développement économique du pays. L’IA représente une voie privilégiée par son potentiel: d’ici dix ans, elle est susceptible de rapporter près de 43 milliards de dollars pour le pays.
Comment investissent-ils dans l’intelligence artificielle ? Quels sont les moyens mis en place ?
De ces constats, les gouvernements ont fait du développement de toutes les technologies liées à l’IA des priorités nationales.
Ainsi, en Arabie Saoudite, la stratégie gouvernementale pour l’IA se fonde principalement sur le projet Vision 2030 de diversification de l’économie. À celui-ci, s’ajoute un programme du nom de National Strategy for Data and AI (NSDAI) révélé en octobre 2020 à Riyadh lors du sommet Global de l’IA. L’objectif affiché par Riyad est de transformer pour 2030 le pays en hub mondial de l’intelligence artificielle en réformant totalement tous ses secteurs économiques afin de devenir “IA compatible”. Cette initiative gouvernementale s’accompagne donc de nombreux investissements du Fond Public Saoudien d’Investissement dans les industries, les secteurs privés et dans la mise en place de partenariats publics-privés en vue de développer l’intelligence artificielle. Cette année par exemple, le pays a formé des partenariats avec Google, Amazon et Oracle dans le but de, selon Saudi Press Agency, mettre en place des “programmes de formation" pour les étudiants saoudiens. L’objectif est ambitieux et les moyens de cette stratégie gouvernementale sont colossaux.
Lors du sommet global saoudien de l’intelligence artificielle, le Président saoudien de l’Autorité des données et de l’intelligence artificielle a déclaré : « La stratégie nationale pour les données et l'IA définit l'orientation et les bases sur lesquelles nous allons libérer le potentiel des données et de l'IA pour répondre à nos priorités de transformation nationales et faire de l'Arabie saoudite une plaque tournante mondiale pour les données et l'IA. »
Quant aux Emirats Arabes Unis, la stratégie gouvernementale pour l’IA repose sur le programme Artificial Intelligence Strategy 2031 révélée en 2017. Le but affiché est d’accompagner la transformation digitale du pays pour faire des EAU un hub mondial de l'investissement dans l’intelligence artificielle dans de nombreux secteurs d’une manière “intelligente” et “éthique” en créant un système numérique intelligent pour le centenaire du pays en 2071. De ce fait, le pays a été le premier dans le monde à mettre en place, en 2017, un ministère consacré spécialement à l'IA aux côtés de la création de la Muhammad Ben Zayed University of Artificial Intelligence afin de répondre aux ambitions affichées.
Enfin, en Egypte, le gouvernement a, en 2019, instauré le Conseil National pour l’Intelligence Artificielle dans une logique de partenariats public-privé entre le gouvernement, les universités et les secteurs privés de l’IA. L’université Kafr El Sheikh a ouvert une faculté de l’IA sous l’impulsion gouvernementale. L’objectif affiché par le Ministère des Technologies de l'Information et de la Communication est d’identifier par la recherche les secteurs prioritaires nécessitant l’IA afin de mettre en place un système de l’IA “durable” et “intelligent” dans l'optique de donner au pays un rôle de “leader régional de l’IA”.

Propos introductif
Au-delà du fait que Djibouti se situe sur le continent africain, ce pays mérite d'être abordé dans le cadre d'une analyse sur le monde arabe. En effet, les divers enjeux qui se jouent autour de ce territoire méritent une attention toute particulière pour comprendre une partie des dynamiques politiques actuelles dans le monde arabe.
À ce titre, l’ambition djiboutienne de siéger au sein du conseil de sécurité de l’ONU, pour 2021-2022, témoigne de la volonté de son gouvernement de s’imposer sur la scène internationale et d'y représenter une voix africaine. Cette ambition s’inscrit dans le jeu de puissance qui s'opère au sein de ce territoire, mais avant d’aller plus loin dans les explications sur les motivations animant les dynamiques de ce pays, il convient d’apporter quelques éléments de définition et de contexte.
Tout d’abord, sur le volet géographique, Djibouti a une superficie de 23 200 km². En comparaison, celle de la France est de 643 801 km. Les villes principales de Djibouti sont Ali Sabieh, Dikhil, Arta, Tadjoura et Djibouti qui est la capitale du pays. Les langues officielles sont le français et l’arabe. La devise est le franc djiboutien (1€ = 208 FD, en 2018). Djibouti recense une population de 1 000 000 d’habitants en 2017 selon la Banque mondiale. Elle enregistre une croissance démographique de +1,6%/an. Un peu plus de la moitié de la population est alphabétisée (54,5% en 2015) et la religion majoritaire est l’Islam (96% du pays selon France Diplomatie). Avec son PIB de 1,97 milliard de US$, Djibouti se place au rang de la 49e puissance économique du continent africain sur 54.
Toutefois, Djibouti présente un intérêt des plus stratégiques, à savoir, sa position sur le détroit de Bab-el-Mandeb, un des corridors les plus fréquentés au monde qui contrôle l’accès à la Mer rouge. De surcroît, Djibouti est situé au cœur de l’arc de crise qui s’étend du Sahel au Moyen-Orient. Ses nombreuses crises régionales démontrent l’instabilité de la péninsule, d’où un certain engouement des puissances étrangères à intervenir en son sein.
Mais est-ce vraiment la raison primordiale ? Ces puissances étrangères sont-elles réellement motivées par la volonté de stabiliser cet État et sa région ? Ou bien ces interventions et cette présence extérieure attestent seulement d’une volonté de contrôler et de servir au mieux des intérêts qui façonnent le jeu des États ? Djibouti, au fond, ne serait-elle pas qu’une pièce maîtresse dans la conception prochaine du Moyen-Orient et du Sahel ?
Bien que ces interrogations soulèvent des questions fondamentales voire propices à des débats animés, il est nécessaire d’apporter des éléments historiques (I) dans le but d’identifier les raisons pour lesquelles les puissances extérieures agissent en son sein (II) qui viendront façonner un futur plus ou moins incertain pour la République de Djibouti et pour le Moyen-Orient (III).


En 2005, pour le 60e anniversaire de l’ONU, l’Assemblée Générale des Nations Unies a écrit une page déterminante de l’histoire du droit international. Par un vote unanime, les Etats membres ont adopté dans l’acte final du Sommet mondial un concept promu depuis des années par des juristes et des acteurs humanitaires internationaux : la responsabilité de protéger (souvent abrégée en R2P pour Responsability to Protect). Cette responsabilité impose aux États et, le cas échéant, à la communauté internationale, de protéger les populations contre les crimes graves qui peuvent être commis à leur encontre.
La responsabilité de protéger a marqué une évolution décisive dans la conception juridique des relations internationales. L’espace supranational est régi depuis près de quatre siècles par le “système westphalien”, tiré du Traité de Westphalie de 1648 qui conclut la Guerre de Trente Ans. Ce système est caractérisé par une double définition de la souveraineté des Etats : une souveraineté externe qui s’exprime par une égalité de droit entre les Etats et une souveraineté interne qui confère à chaque Etat une autorité exclusive sur sa population et son territoire. Ce système a connu un important développement au XXe siècle, particulièrement concernant la souveraineté externe. De l’Entre-Deux-Guerres à l’issue de la Deuxième Guerre Mondiale, divers acteurs ont tenté de donner sa pleine puissance au concept de souveraineté externe en mettant “la guerre hors-la-loi” (Expression du ministre des Affaires Etrangères français, Aristide Briand, lors de sa présentation du pacte Kellog-Briand à l’Assemblée Nationale le 1er mars 2029), que ce soit par le Pacte Kellog-Briand ou par la Charte des Nations Unis. En revanche, le volet interne de la souveraineté demeurait l’angle mort du développement sécuritaire des Nations Unies. A l’exception de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide de 1948, peu de règles internationales régissaient les rapports entre un Etat et ses populations.
Néanmoins, à la sortie de la Guerre Froide, les conflits intra-étatiques et la protection des droits humains sont redevenus un enjeu majeur du droit international. Les années 1990 sont marquées par deux crises humanitaires que sont la guerre civile de Yougoslavie (1991-2001) et la guerre civile Rwandaise (1990-1994) qui prit un tournant génocidaire dans sa dernière année avec le massacre de près de 800 000 Tutsis et Hutus accusés de sympathiser avec l’ethnie massacrée (Rapport de l’ONU sur le génocide au Rwanda, 1999 : “Quelque 800 000 personnes ont été massacrées lors du génocide de 1994 au Rwanda”). Dans ce contexte de conflits internes, qu’ils soient hérités de la Décolonisation et de la Guerre Froide ou qu’ils s’agissent des “Nouvelles Guerres” caractéristiques de l’espace international post-Guerre Froide (KALDOR, Mary, New and Old Wars : Organized Violence in a Global Era, 2012), des acteurs politiques et humanitaires internationaux ont promu une évolution du droit pour prévenir de futurs excès de violence d’une telle ampleur.
Dès 1987, un colloque international organisé par la faculté de droit de Paris-Sud fait adopter à l’unanimité une résolution affirmant que “devraient être reconnus [...] par tous les Etats membres de la communauté internationale, à la fois le droit des victimes à l’assistance humanitaire et l’obligation des Etats d’y apporter leur contribution”. Cette résolution, qui sera portée plus tard devant les Nations Unies par la France, a notamment obtenu le soutien du juriste international de renom Mario Bettati et du fondateur de Médecins Sans Frontières Bernard Kouchner. Tandis que cette idée de “droit d’ingérence humanitaire” se répandait, deux discours allaient accélérer le passage au droit positif d’un concept de protection internationale des populations dans un cadre étatique.
Le premier fut donné par le Président de l’Afrique du Sud, Nelson Mandela, au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine à Ouagadougou, Burkina-Faso, en 1998. Nelson Mandela argumentait dans ce discours que le continent africain, partageant la marque du colonialisme et le néo-colonialisme, formait une communauté de destin et devait, en tant que tel, assurer communément la paix et la stabilité en son sein. Nelson Mandela, insistant sur la gestion commune de la sécurité qu’il promouvait pour le continent africain, affirmait qu’il était inacceptable “d’abuser du concept de souveraineté nationale pour nier au reste du continent le droit et le devoir d’intervenir, quand, au sein de cette souveraineté, le peuple est massacré pour protéger la tyrannie”.
Le second discours est celui du Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, devant l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2000 alors que le débat autour de l’intervention humanitaire divise la communauté internationale. A cette occasion, il déclara “s’il l’intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme, qui vont à l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’être humain ?”. Ce discours marqua le début du processus de formalisation de la responsabilité de protéger et son intégration finale au droit international promu par les Nations Unies.